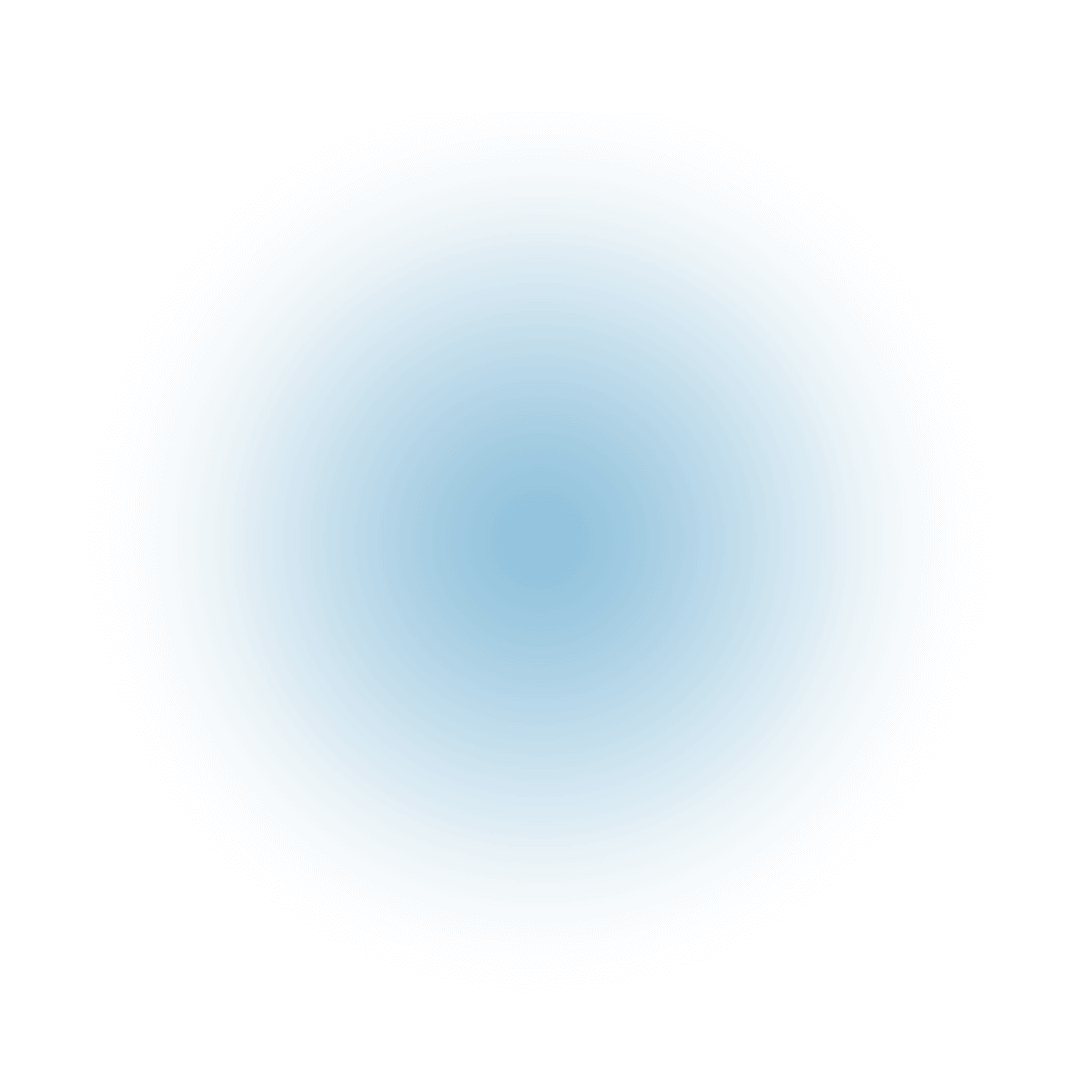
Combien coûte un Security Operations Center (SOC) ?


Longtemps réservé aux entreprises de grande envergure, le Security Operations Center (SOC) ou Centre d’opérations de sécurité s’ouvre désormais aux sociétés de toutes tailles.
Portée par l’augmentation constante du volume de cyberattaques et par un cadre réglementaire de plus en plus exigeant, l’adoption d’un SOC n’implique plus nécessairement le recrutement interne d’analystes ni des investissements massifs dans des infrastructures de cybersécurité.
Grâce à une prise de conscience généralisée des risques, la demande croissante de s’appuyer sur un service SOC permet aujourd’hui aux entreprises spécialisées en cybersécurité (MSSP) de proposer des offres managées à des tarifs compétitifs.
Si cette démocratisation ouvre de nouvelles perspectives, elle s’accompagne aussi d’une profusion d’offres hétérogènes, qui si elles ont le même nom, ne proposent pas dans les faits la même chose.
D’où la nécessité de se poser les bonnes questions :
- Combien coûte un Security Operations Center ?
- Quels sont les services inclus dans une offre SOC ?
- Quelles options peuvent faire varier le budget ?
- Comment éviter les dérives budgétaires ?
Réponse de nos experts dans cet article.
Qu’est-ce qu’un SOC (Security Operations Center) ?
Un SOC (Security Operations Center) désigne un service composé d’analystes en cybersécurité dont la fonction est d’analyser en continu, de détecter et de remédier à des menaces à partir des événements se produisant sur votre système d’information.
Une offre de SOC managé (opéré par un tiers) s’adapte selon les besoins et les budgets. Le service est systématiquement dimensionné en fonction des risques business et sécurité et couvre de manière progressive l’ensemble du système d’information. Ce service est par défaut activé pendant les heures ouvrées, et étendu sur des plages horaires plus importantes : le soir, le week-end et jours fériés compris. La prise en compte de ces horaires se fait dans un mode d’astreinte avec une couverture follow-the Sun.
SOC : un service complexe, aujourd’hui accessible à toutes les entreprises ?
Sur le marché français, les offres SOC ont été stimulées par l’action des pouvoirs publics. Encadrées par des réglementations comme NIS2 ou DORA, qui consacrent le SOC comme un pilier incontournable de la cybersécurité, les entreprises de toutes tailles sont désormais appelées à renforcer leur posture de sécurité.
Malheureusement pour beaucoup d’entre elles, ce niveau d’investissement ne peut être soutenu c’est pourquoi l’État français a intégré la cybersécurité dans son plan de relance intitulé France 2030.
Une dynamique qui simplifie l’accès à ce service, comme le souligne Charles Melin Associé – Directeur Conseil, SOC & CERTchez Formind : « grâce au plan France 2030, l’État mobilise plus d’un milliard d’euros – dont quelque 720 millions de financements directs – pour soutenir la filière cybersécurité. Cette enveloppe se traduit par des subventions (diagnostics, investissements, recrutements) qui abaissent la barrière d’entrée et créent un puissant effet d’entraînement pour les organisations prêtes à déployer ou renforcer leur SOC. »
Combien coûte un SOC ?
Si les dispositifs publics (comme France 2030) et la pression réglementaire (NIS2, DORA) contribuent à abaisser la barrière d’entrée, la question essentielle demeure : quel budget prévoir pour un SOC ?
Prenons l’exemple d’une entreprise disposant d’environ 1 000 endpoints, 100 serveurs et 3,5 To de logs ingérés par an.
- SOC opéré en interne : le coût humain nécessaire pour assurer une couverture 24/7 s’élève à environ 280 000 € (soit l’équivalent de 3 ETP, incluant astreintes et coordination). À cela s’ajoutent environ 50 000 € de licences et d’outils (SIEM, EDR/XDR, SOAR, etc.), soit un budget total d’environ 330 000 € par an pour un SOC interne complet.
- SOC externalisé (managé) : grâce à la mutualisation des équipes et des compétences, le coût d’un service managé incluant la surveillance 24/7, les outils et leur exploitation se situe autour de 150 000 € à 220 000 € par an, selon le niveau de service, la volumétrie et les cas d’usage couverts.
Ainsi, le choix entre un SOC interne ou externalisé dépend principalement du niveau de contrôle souhaité, de la maturité cybersécurité et de la capacité à absorber les coûts humains et technologiques en interne.
Si le SOC interne est nettement plus onéreux, il finance une capacité complète : recrutement, formation, continuité 24/7, encadrement, plateformes et outillage, processus. L’internalisation se justifie surtout pour des volumes de données très élevés, des exigences de souveraineté fortes ou une stratégie de maîtrise complète des moyens de cybersécurité.
À l’inverse, le SOC externalisé est un service prêt à l’emploi assorti d’engagements, généralement bien moins coûteux sur un périmètre défini et adapté pour les PME et ETI.
Quels critères font évoluer le prix d’une offre SOC ?
Qu’il soit interne, hybride ou externalisé, le coût d’une offre SOC peut évoluer en fonction du périmètre : nombre d’assets et volume journalier d’ingestion des logs.
Périmètre et stratégie de déploiement
Le coût d’une offre SOC dépend d’abord du périmètre à surveiller. Pour cela, la première étape est d’identifier les actifs critiques (processus, données, systèmes), cartographier les risques, puis définir comment ils seront surveillés (stratégie de supervision) et comment corréler et remonter les données vers le SIEM.
Comme le souligne Charles Melin : « La bonne pratique est de diviser le périmètre puis de le traiter segment par segment : on commence par le poste de travail / serveur, on ajoute progressivement l’infrastructure en cœur de réseau, puis en bordure de réseau, puis on traite la brique métier. Vouloir tout couvrir en une fois augmente significativement les coûts projets… et dégrade la qualité de détection. »
Ce cadrage sert aussi à comprendre le fonctionnement interne de l’entreprise puis à définir les cas d’usage (ce qui doit déclencher une alerte) et à choisir les sources de logs réellement utiles (y compris les outils capables de générer des alertes “natives”).
—–
Bonne pratique : partir du cadrage pas du devis.
Il est recommandé de toujours cadrer avant de consulter. La bonne stratégie consiste à faire valider l’ambition et le budget par la direction, puis de lancer le projet. Le cas échéant, toutes les parties prenantes dépensent de l’énergie… et il n’est pas rare de découvrir trop tard que le budget n’est pas en corrélation avec le projet initial.
——
BUILD – mise en œuvre & intégrations : payer pour des alertes utiles, pas pour du bruit
Une fois le périmètre établi, la composante “solutions logicielles” devient centrale dans le budget d’un SOC. Deux facteurs influencent alors fortement le coût : les licences des plateformes de sécurité et la volumétrie de données à traiter.
Une erreur classique consiste à faire de l’acquisition de solutions logicielles (EDR, pare-feu, etc) mais qui ne sont pas managées faute de ressources internes.
Des investissements conséquents sont faits, mais les outils ne sont pas pleinement utilisés voire dans certains cas sont inadaptés et génèrent du bruit pour les analystes. Il ne faut donc pas confondre l’investissement dans des licences (les outils) et le service attendu (détecter, investiguer et répondre).
Avant de faire le choix d’une solution technologique, posez-vous ces trois questions :
- Que souhaitons-nous détecter en priorité ? (ex. vol de compte utilisateur, rançongiciel, comportement anormal)
- Quelles traces sont vraiment utiles pour cette détection ? Identifier les journaux d’événements (logs) nécessaires et éviter le “tout connecté” qui alourdit les coûts sans améliorer la détection.
- Quels outils ont le droit de créer une alerte ? Une alerte déclenche un traitement humain (tri, investigation, remédiation). Pour éviter l’emballement, il faut limiter l’émission d’alertes aux équipements réellement utiles.
——-
Bonne pratique : privilégier la qualité des signaux
Il est recommandé d’éviter le réflexe de remonter systématiquement toute information vers le SIEM car comme le dit l’adage “trop de données tuent les données”.
Une amplification du bruit qui impacte également le coût de cette offre. Plus la volumétrie augmente, plus le coût de stockage (le data lake) sera important. À l’inverse, quelques signaux bien choisis produisent des alertes actionnables, moins nombreuses et plus rapides à traiter.
——-
RUN : adapter la surveillance quotidienne à votre contexte (et à votre budget)
Le RUN désigne l’étape où le SOC produit réellement de la valeur : surveillance des signaux, qualification des alertes, investigation, remédiation et, si nécessaire, escalade. Comme le résume Geoffrey Montel Manager SOC chez Formind : « après l’implémentation (le BUILD) s’ouvre la phase de RUN : un traitement quotidien des alertes et des incidents, assorti d’une amélioration continue structurée en comité ». Autrement dit, l’exploitation devient un rythme, et ce rythme doit coller à la réalité du terrain.
Cette réalité dicte l’effort à fournir. La charge varie d’abord avec le volume d’alertes, plus il y a de signaux à qualifier, plus l’équipe travaille.
Pour maintenir ce rythme, de plus en plus de SOC intègrent désormais des briques d’intelligences artificielles capables d’automatiser une partie du traitement des alertes.
Comme le rappelle Charles Melin : « La standardisation de la réponse aux alertes par l’IA permet d’automatiser une partie des tâches de niveau 1 (tri, qualification, actions simples), réduisant jusqu’à trois le coût de ces opérations. »
Cette automatisation ne remplace pas l’expertise humaine : elle permet au contraire de focaliser les analystes sur les incidents critiques, améliorant la rapidité de traitement et la qualité des investigations.
Le pilotage au quotidien est également un poste de coûts, incluant les réunions et comptes rendus.
Ce poste couvre les comités de suivi réguliers, revues d’incidents et revues de performance. Le prestataire prépare ces rendez-vous (analyses, tableaux de bord), les anime, formalise les décisions et suit les plans d’action. Ce temps est budgété et figure au devis.
La charge de surveillance varie aussi selon la plage de couverture retenue — heures ouvrées, horaires étendus ou surveillance en continu — ainsi que de l’éventuelle astreinte en dehors des heures habituelles.
——
Bonne pratique : étendre la couverture horaire par palier
La trajectoire la plus maîtrisée consiste à faire évoluer le service progressivement. Démarrer sur des horaires ouvrés, mesurer quand surviennent les alertes et lesquelles exigent une réponse rapide, puis élargir la couverture seulement si les faits le justifient.
——-
Au-delà du coût : quels sont les gains financiers d’un SOC ?
La question du budget en matière de cybersécurité est souvent délicate et il est parfois difficile d’en justifier les bénéfices. Pour objectiver la décision, l’ENISA a popularisé en 2012 l’indicateur ROSI (Return on Security Investment) qui répond à une question simple : quelle perte évitée grâce à la sécurité informatique ?
Comme le résume Geoffrey Montel : « Il s’agit d’évaluer l’économie de temps et de moyens réalisée sur des incidents (arrêts d’activité, interventions d’urgence, pénalités, gestion de crise) par rapport au coût des mesures mises en place. »
Ainsi, l’utilisation d’un SOC se valorise de différentes manières :
- Réduction des coûts directs liés aux incidents : un SOC limite les arrêts de production, les pertes de données ou les sanctions réglementaires.
- Diminution des primes d’assurance cyber : un dispositif de surveillance et de réponse reconnu par les assureurs améliore le profil de risque et peut conduire à des conditions plus avantageuses, voire à un accès facilité à la couverture.
- Gain en productivité pour les équipes internes : la supervision continue étant assurée par des experts dédiés, les équipes IT peuvent se concentrer sur des projets à plus forte valeur ajoutée, comme la sécurisation des applications métiers ou la gouvernance des données.
- Effet de confiance et de crédibilité commerciale : disposer d’un SOC opérationnel renforce la posture de sécurité perçue par les clients, partenaires et donneurs d’ordre. C’est un facteur différenciant dans les appels d’offres ou les relations avec des acteurs soumis à des exigences réglementaires élevées.
Formind offre un SOC managé avec des coûts maîtrisés
Formind opère un service SOC pour les entreprises qui veulent concilier sécurité et budget. Notre promesse est simple : des résultats mesurables avec un coût prévisible, dès la phase de BUILD (implémentation), puis tout au long de la phase de RUN (production).
Ainsi, faire le choix de Formind, c’est bénéficier :
1. Expertise‑conseil intégrée. Le SOC de Formind est bâti autour d’analystes qui sont aussi consultants. Cette double compétence leur permet de paramétrer les technologies EDR/XDR‑SIEM et SOAR tout en alignant la détection sur les risques métiers du client.
2. SOC ouvert et interopérable. Le SOC Formind s’adapte à l’environnement existant du client sans imposer d’outils ou de migrations techniques. Il peut communiquer avec tout type de solutions de sécurité déjà en place et centraliser leurs alertes au sein d’une supervision unifiée.
3. Gouvernance client et réversibilité native. Vous restez propriétaire des licences, des logs et de la configuration : tout est déployé sur vos environnements (cloud ou on‑premise). Apportant ainsi :
- Une réversibilité si vous internalisez ce service ou si vous souhaitez changer de prestataire ;
- Une transparence totale sur les règles de détection, les métriques MTTR/MTTD, les rapports ainsi que l’accès aux outils que Formind intègre ;
- Une traçabilité complète des actions d’investigation (horodatage, analyste, justification).
4. Accompagnement continu. De la phase de Build au Run, vous bénéficiez d’un accompagnement continu : réunions de lancement, lecture des tableaux de bord, comités de suivi, ateliers de crise et formation (y compris travaux pratiques). Le SOC ne se limite pas à la gestion de tickets, il structure la sécurité opérationnelle au quotidien avec une approche pragmatique pensée selon les besoins et les contraintes propres à chaque secteur.
5. Couverture 24/7 native. Tous nos analystes répartis entre la France, le Canada, Taïwan, le Maroc assurent une surveillance « follow‑the‑sun ». Le relais entre équipes sur plusieurs fuseaux garantit la continuité de la surveillance et permet d’ajouter de nouvelles entités (post-fusion, nouvelles agences) en réappliquant les mêmes référentiels : cas d’usage, tableaux de bord, processus d’escalade.
6. Certification ISO 27001. Formind est certifiée ISO 27001, une exigence encore rare parmi les offres de SOC managé. Cette certification permet à nos clients de bénéficier d’un SOC aligné sur des pratiques rigoureuses et auditées régulièrement. Elle constitue un atout majeur pour les entreprises soumises à des exigences réglementaires ou sectorielles élevées
Vous avez un projet de SOC managé ou
pour en savoir plus sur nos différentes offres


